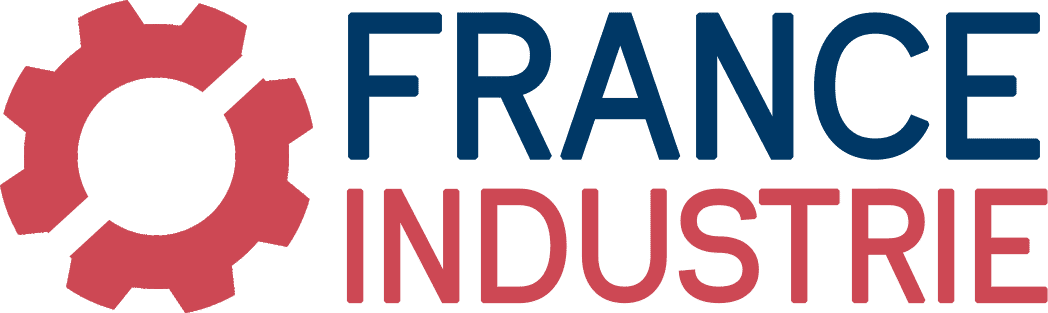Bilan carbone de l’industrie textile : de quoi parle-t-on ?
Quel est le bilan carbone de l’industrie textile ?
Le bilan carbone d’un secteur ou d’une entreprise correspond à la somme de ses émissions de gaz à effet de serre, exprimées en CO₂ équivalent, sur une période donnée (souvent une année). Il se décompose en trois périmètres :
- Scope 1 : émissions directes (combustion sur site, procédés industriels).
- Scope 2 : émissions liées à l’électricité, à la chaleur ou à la vapeur achetées.
- Scope 3 : tout le reste de la chaîne de valeur (matières premières, transport, usage des produits, fin de vie…).
Dans le textile, le Scope 3 pèse largement le plus lourd :
- production des fibres (coton, polyester, viscose, etc.) ;
- transformation (filature, tissage, tricotage) ;
- ennoblissement (teinture, apprêts) ;
- logistique et distribution ;
- usage (lavage, séchage, repassage) ;
- fin de vie (collecte, tri, incinération ou recyclage).
À l’échelle mondiale, les études convergent vers une empreinte annuelle de 3 à 4 milliards de tonnes de CO₂e pour la mode et le textile au sens large.
En France, une étude sectorielle estime que le textile représente environ 10 % de l’empreinte carbone de l’industrie manufacturière, avec plus de 10 millions de tonnes de CO₂e, dont la grande majorité liée aux importations.
Des ordres de grandeur pour situer l’impact climatique du textile
Pour mesurer l’importance du sujet, quelques chiffres structurants :
- Dans l’Union européenne, les achats de textiles (vêtements, linge, etc.) ont généré environ 121 millions de tonnes de CO₂e en 2020, soit 270 kg de CO₂e par habitant.
- À l’échelle mondiale, la mode et le textile sont généralement crédités de 3,3 à 4 milliards de tonnes de CO₂e par an, soit quelques pourcents des émissions globales.
- Sur le cycle de vie d’un vêtement, la phase de fabrication (de la fibre au produit fini) concentre la majorité des émissions, loin devant l’usage ou la fin de vie.
Ces ordres de grandeur rendent le textile hautement visible dans les politiques climat :
- il figure dans les priorités de l’Union européenne pour la consommation durable
- il est ciblé par plusieurs dispositifs nationaux (économie circulaire, obligations d’information, REP, etc.).
Pour un industriel, l’enjeu n’est donc pas marginal : à volume constant, la pression pour décarboner va mécaniquement s’intensifier dans les années à venir.
Où se concentrent les émissions sur la chaîne de valeur textile ?
Le bilan carbone de l’industrie textile se répartit sur plusieurs grands postes. Les proportions exactes varient selon les études, les matières et les pays, mais la structure reste similaire.
1. Production des matières premières
- Coton : consommation d’eau, engrais, pesticides, énergie pour l’irrigation.
- Fibres synthétiques (polyester, nylon, etc.) : issues de la pétrochimie, très dépendantes des énergies fossiles.
- Fibres artificielles (viscose, modal, etc.) : issues de la cellulose, avec un enjeu fort sur la gestion forestière et la chimie associée.
C’est souvent le premier poste d’émissions, en particulier pour le coton et le polyester.
2. Filature, tissage, tricotage
Cette phase est fortement consommatrice d’énergie électrique (machines de filature, métiers à tisser, tricoteuses). Selon les cas, elle représente une part significative des émissions de fabrication d’un vêtement.
3. Ennoblissement : teinture, lavage, apprêts
- Procédés très énergivores (chauffage des bains, séchage).
- Usage de produits chimiques nécessitant traitements d’effluents.
L’impact climat est lié à l’énergie, mais aussi aux émissions indirectes liées à la production de ces produits chimiques.
4. Confection et logistique
- La confection en elle-même est moins émettrice que les phases précédentes, mais reste significative à l’échelle mondiale.
- La logistique internationale (transport maritime, aérien, routier) ajoute une couche d’émissions, notamment pour les flux urgents ou aériens.
5. Usage et fin de vie
- Lavage, séchage et repassage génèrent des émissions côté consommateur, dépendantes du mix électrique du pays.
- La fin de vie (incinération, enfouissement, recyclage) reste un poste minoritaire sur le plan carbone, mais stratégique pour l’économie circulaire et les matières secondaires.
Spécificités du bilan carbone textile pour les industriels français
Pour un industriel implanté en France ou en Europe, le bilan carbone du textile a plusieurs caractéristiques :
- Une majorité d’émissions “importées”
La plus grande part des émissions a lieu en dehors de l’UE : production des fibres, transformation et confection dans des pays à énergie carbonée. - Une pression réglementaire croissante
- renforcement des exigences d’information environnementale sur les produits (affichage environnemental, éco-score textile) ;
- responsabilité élargie des producteurs (REP TLC) sur la fin de vie ;
- obligations de reporting climat pour les grandes entreprises (CSRD, taxonomie).
- renforcement des exigences d’information environnementale sur les produits (affichage environnemental, éco-score textile) ;
- Un risque économique réel
- risques d’écotaxe ou de malus sur les produits à forte empreinte carbone ;
- risque d’ajustement carbone aux frontières pour certains intrants très émetteurs ;
- pression des donneurs d’ordres et distributeurs sur les indicateurs climat.
- risques d’écotaxe ou de malus sur les produits à forte empreinte carbone ;
- Une opportunité de repositionnement industriel
- relocalisation partielle de certaines étapes (tissage, ennoblissement, confection spécialisée) ;
- différenciation par des textiles à plus faible empreinte, des processus optimisés et une meilleure traçabilité.
- relocalisation partielle de certaines étapes (tissage, ennoblissement, confection spécialisée) ;
Comment un industriel du textile peut réduire son bilan carbone ?
La décarbonation du textile n’est pas qu’un discours. Elle passe par des choix techniques et économiques à chaque étape de la chaîne.
1. Agir sur les matières
- augmenter la part de matières à plus faible empreinte (fibres recyclées, lin, chanvre, fibres artificielles de nouvelle génération…) ;
- travailler avec des fournisseurs engagés (énergie décarbonée, certifications environnementales, plans de réduction des émissions).
2. Optimiser l’énergie des sites industriels
- audits énergétiques des lignes de filature, tissage, tricotage, teinture ;
- récupération de chaleur, isolation, optimisation des moteurs et compresseurs ;
- substitution progressive par des énergies renouvelables (PPA, autoconsommation, chaleur renouvelable).
3. Écoconcevoir les produits
- réduire le poids matière à impact élevé ;
- concevoir des produits plus durables, réparables et recyclables ;
- limiter la multiplicité des matières dans un même produit pour faciliter le recyclage.
4. Piloter les flux logistiques
- privilégier le maritime ou le ferroviaire sur l’aérien ;
- optimiser les taux de remplissage ;
- rapprocher certaines étapes clés des marchés de consommation quand cela a du sens (nearshoring).
5. Mobiliser la filière et les clients
- co-construire des plans climat avec les donneurs d’ordre ;
- proposer des offres de réparation, reprise, réemploi ;
- rendre visibles les gains carbone dans les argumentaires B2B.
Mesurer pour agir : outils et références pour le bilan carbone textile
Aucune stratégie de réduction crédible sans mesure structurée. Pour un industriel du textile, la feuille de route passe par plusieurs étapes :
- Réaliser un bilan carbone complet
- s’appuyer sur des méthodologies reconnues (Bilan Carbone®, GHG Protocol) ;
- couvrir au minimum les Scopes 1, 2 et les postes majeurs du Scope 3 (matières, transport, déchets).
- s’appuyer sur des méthodologies reconnues (Bilan Carbone®, GHG Protocol) ;
- S’aligner sur des référentiels et benchmarks
Il existe aujourd’hui des repères publics utiles pour situer son site par rapport au reste du marché, par exemple les données de l’Agence européenne pour l’environnement sur les émissions liées aux achats de textiles dans l’UE, relayées par le Parlement européen.
Ces ordres de grandeur aident à fixer des objectifs réalistes mais ambitieux. - Définir des objectifs de réduction crédibles
- objectifs chiffrés à 5–10 ans, en cohérence avec une trajectoire 1,5–2 °C ;
- priorisation des investissements à plus fort impact carbone par euro investi ;
- suivi annuel et intégration dans la gouvernance (bonus, critères d’investissement, etc.).
- objectifs chiffrés à 5–10 ans, en cohérence avec une trajectoire 1,5–2 °C ;
- Industrialiser le reporting climat
- automatisation de la collecte de données (ERP, MES, achats, transport) ;
- rapprochement avec les exigences de la CSRD pour les groupes concernés ;
- communication transparente auprès des clients B2B.
- automatisation de la collecte de données (ERP, MES, achats, transport) ;
Conclusion : le bilan carbone, nouveau pilier stratégique du textile
Le bilan carbone de l’industrie textile n’est plus un sujet périphérique. C’est un indicateur clé de performance au même titre que le coût matière, la qualité ou le délai.
Pour un industriel français, la question n’est plus “faut-il s’y mettre ?” mais “où se situent mes principaux gisements de réduction, et comment les exploiter sans dégrader ma compétitivité ?”. La bonne nouvelle : une large part des leviers (énergie, process, matières, logistique) améliore aussi la maîtrise des coûts et la résilience de la supply chain.
Engager une démarche structurée de mesure, de réduction et de reporting climat, c’est donc préparer son outil industriel aux contraintes de demain… tout en répondant dès aujourd’hui aux attentes des donneurs d’ordre et des pouvoirs publics.
>> Cet article pourrait également vous intéresser : Quel est l’impact du textile sur l’environnement ?