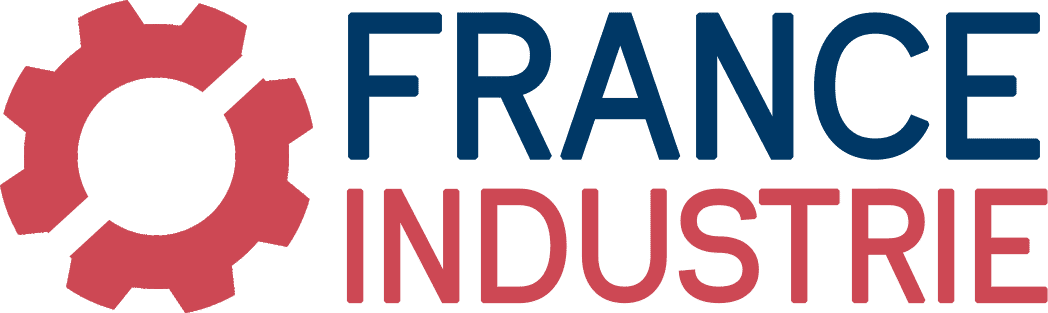Le coton
Fruit du cotonnier « véritable », le coton est aujourd’hui la première fibre textile consommée dans le monde. Mais derrière ces petites boules duveteuses se cache pourtant une réalité contrastée. Enquête sur cet « or blanc » tant convoité.
Quelle est la nature de coton ?
La nature du coton est celle d’une fibre végétale. Le coton est une fibre naturelle qui provient des graines du cotonnier, une plante de la famille des Malvaceae. Il s’agit d’une fibre douce, légère et respirante qui est largement utilisée dans l’industrie textile pour la fabrication de vêtements, de linge de maison, de textiles d’ameublement et d’autres produits.
La nature végétale du coton en fait une ressource renouvelable et biodégradable. Il est cultivé dans de nombreuses régions du monde, et les fibres de coton peuvent être récoltées, transformées en fils et tissées pour créer différents types de tissus.
Le coton en tant que fibre végétale offre des avantages tels que sa douceur, sa respirabilité, sa capacité à absorber l’humidité et son confort au contact de la peau. Il est également facile à teindre et à entretenir.

La culture du coton
De la germination à la récolte, le coton suit un cycle de vie bien rôdé :
- La phase de croissance : la graine initiale se métamorphose en une superbe fleur jaune-orange, puis rose ;
- La phase de séchage : la fleur se mue en une capsule oblongue et rigide ;
- La phase d’éclosion : la capsule s’ouvre et libère entre 20 et 40 graines, entourées d’une houppe de fibres de coton blanches.
Toutes ces étapes requièrent des conditions climatiques propres. Pendant la période de croissance, le coton exige une quantité d’eau impressionnante : au moins 120 jours de pluies abondantes ! En revanche, il a besoin d’un temps sec et chaud lors de la maturation des graines. Le coton aime donc particulièrement les climats tropicaux ou subtropicaux. Toutefois, la pluie ne suffit pas toujours à étancher sa soif : une irrigation complémentaire demeure nécessaire en deçà de 700 mm de précipitations annuelles.
Parmi les leaders de la production mondiale : la Chine, l’Inde, les États-Unis, le Brésil, le Pakistan, l’Ouzbékistan et l’Afrique subsaharienne. Si la culture du coton est essentiellement manuelle dans les pays en développement, elle est très mécanisée sur le continent américain.

Quelle est la composition chimique du coton ?
Le coton est principalement composé d’une substance appelée cellulose. La cellulose est un peu comme un long fil fabriqué à partir de petits morceaux de sucre appelés glucose. Ces fils de cellulose sont regroupés pour former les fibres du coton. Outre la cellulose, le coton contient également d’autres composants tels que des protéines, des lipides, des cires et des substances minérales. Ces composants sont présents en quantités relativement faibles par rapport à la cellulose.
Les caractéristiques du coton
Très prisé pour son faible coût, le coton dispose de bien d’autres avantages. Léger, respirant, doux : il est avant tout synonyme de confort. Non irritant au contact des muqueuses, il est une fibre de choix pour les sous-vêtements. Hypoallergénique, il convient parfaitement aux peaux sensibles et aux nourrissons. Le coton est une matière première facilement personnalisable. Teinture, impression de motifs, empesage : il autorise de nombreuses fantaisies. Il reste également facile d’entretien : il supporte tant un lavage à haute température qu’un nettoyage à sec, et peut être repassé sans problème.
Plus insolite : le coton pourrait envahir le champ de la médecine. Il renfermerait une molécule permettant de traiter l’ostéoporose – selon une étude publiée dans le Journal of American Chemical Society en 2009.
Les tissus à base de coton
Le tissu de coton est un matériau textile fabriqué à partir de fibres de coton. Ces fibres sont obtenues à partir des graines de coton, qui sont récoltées des plantes de coton. Le coton est l’une des fibres naturelles les plus couramment utilisées dans l’industrie textile en raison de ses propriétés et de sa disponibilité.
Le tissu de coton est apprécié pour sa douceur, sa respirabilité et sa capacité à absorber l’humidité. Il est confortable à porter et adapté aux climats chauds, car il permet à l’air de circuler autour du corps. Le coton est également durable et résistant, ce qui en fait un choix populaire pour les vêtements et les textiles domestiques.
En termes de soins, le tissu de coton est généralement facile à entretenir. Il peut être lavé en machine et repassé à des températures modérées. Cependant, certains types de tissus de coton peuvent rétrécir s’ils sont soumis à des températures élevées, il est donc important de suivre les instructions spécifiques d’entretien pour chaque article en coton.
Voici quelques tissus de coton couramment rencontrés :
- La percale : formé de coton pur ou d’un mélange polyester-coton, il est très convoité en literie pour son toucher soyeux,
- Le pilou : employé pour la confection de pyjamas, il est plutôt pelucheux,
- Le calicot : plus grossier et peu onéreux, il est parfait pour concevoir des rideaux ou des sacs à pain robustes.
Comment savoir si un tissu est 100% coton ?
Pour déterminer si un tissu est composé à 100% de coton, vous pouvez effectuer quelques vérifications :
Lisez l’étiquette
La première étape consiste à vérifier l’étiquette du produit textile. La plupart des vêtements et des tissus comportent une étiquette qui indique la composition du matériau. Recherchez des mentions telles que « 100% coton » ou « Pure coton ». Si l’étiquette indique clairement que le tissu est 100% coton, vous pouvez avoir confiance en cette information.
Vérifiez la sensation au toucher
Le coton a une texture douce et naturelle. Lorsque vous touchez le tissu, il devrait être doux et légèrement texturé, avec une sensation agréable au contact de la peau. Si le tissu semble synthétique, glissant ou rugueux, il y a de fortes chances qu’il ne soit pas entièrement en coton.
Observez le tissu
Examinez attentivement le tissu pour identifier des indices visuels. Le coton a souvent une apparence mate plutôt que brillante. Il peut également présenter de légères irrégularités dans le tissage. Si vous observez des fibres naturelles ou des petits points à la surface, cela peut indiquer la présence de coton.
Effectuez un test de combustion (optionnel)
Cela doit être fait avec prudence et uniquement si vous êtes sûr de pouvoir manipuler le feu en toute sécurité. Prélevez un petit échantillon du tissu et brûlez-le à l’aide d’une flamme. Le coton brûle relativement lentement, avec une flamme jaune-orange et une odeur de papier brûlé. Les fibres synthétiques, en revanche, fondent souvent rapidement et dégagent une odeur de plastique.
Est-ce que le coton est recyclable ?
Oui, le coton est recyclable. En tant que fibre naturelle, le coton peut être recyclé et transformé en de nouveaux produits textiles ou utilisé comme matière première pour d’autres applications.
Le recyclage du coton peut se faire de différentes manières :
Recyclage mécanique
Le recyclage mécanique du coton implique de transformer les vieux vêtements, les textiles usagés ou les déchets de coton en fibres de coton réutilisables. Les vêtements en coton sont décomposés en fibres, puis nettoyés, cardés et filés pour obtenir de nouveaux fils de coton. Ces fils peuvent ensuite être utilisés pour la fabrication de nouveaux textiles.
Recyclage chimique
Le recyclage chimique du coton est une méthode plus avancée qui utilise des procédés chimiques pour dissoudre le coton en une solution, puis régénérer les fibres de cellulose pour en faire de nouvelles fibres. Cette technique permet de recycler des mélanges de coton ou des tissus contenant d’autres fibres.
Réutilisation et revalorisation
Avant même d’envisager le recyclage, le coton peut être réutilisé et revalorisé. Les vieux vêtements en coton peuvent être donnés ou revendus pour une utilisation ultérieure, réduisant ainsi le besoin de production de nouveaux articles.
Le recyclage du coton peut présenter certains défis en raison des mélanges de fibres, des traitements chimiques appliqués au tissu et des variations de qualité. Cependant, de nombreuses initiatives et technologies sont développées pour améliorer le recyclage du coton et en faire une option plus viable sur le plan environnemental.
En recyclant le coton, nous pouvons réduire la quantité de déchets textiles et la demande de nouvelles matières premières, contribuant ainsi à une économie plus circulaire et durable.
L’impact environnemental du coton
La culture du coton conventionnel n’est pourtant pas sans conséquence. Tout d’abord, elle pose le problème de la pollution des sols. Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le coton s’octroie au moins 10 % des pesticides mondiaux. L’explication mathématique est toute trouvée : 1 kg de produits phytosanitaires pour traiter un hectare de cotonniers. Des chiffres inquiétants, tant pour la contamination des nappes phréatiques que pour la santé des petits paysans qui travaillent souvent sans protection.
Ensuite, le coton est si gourmand en eau qu’il épuise les ressources naturelles. L’organisation WWF estime que la culture et la transformation de 1 kg de coton nécessitent 20 000 litres d eau ! Une irrigation massive qui explique en partie l’assèchement catastrophique de la mer d’Aral, le plus grand lac du monde dans les années 1960.
Ultime point noir : l’apparition de cotonniers OGM lancés par Monsanto, capables de produire leur propre insecticide. Résultat ? Une augmentation du rendement au détriment de la qualité. Un constat qui a notamment conduit le Burkina Faso à délaisser ces types de semences en 2016.
Le coton bio
Le coton bio, également connu sous le nom de coton biologique, est cultivé selon des normes et des pratiques agricoles spécifiques qui visent à minimiser l’impact sur l’environnement et à promouvoir une agriculture plus durable.
Voici quelques caractéristiques du coton bio :
- Culture sans pesticides et sans engrais chimiques : Le coton bio est cultivé sans l’utilisation de pesticides synthétiques ni d’engrais chimiques. Au lieu de cela, des méthodes alternatives de gestion des parasites et des maladies sont utilisées, telles que la rotation des cultures, l’utilisation de pièges à insectes naturels, et la promotion de la biodiversité pour favoriser les prédateurs naturels.
- Non-OGM : Le coton biologique est cultivé à partir de variétés de coton non génétiquement modifiées. Les agriculteurs utilisent des semences de coton qui sont naturelles et non modifiées génétiquement.
- Conservation de l’eau : Les pratiques de culture du coton bio sont conçues pour optimiser l’utilisation de l’eau et minimiser la consommation excessive. Cela peut inclure des techniques de gestion de l’irrigation, la collecte et l’utilisation d’eau de pluie, et l’amélioration de l’efficacité de l’irrigation.
- Respect des normes environnementales et sociales : Le coton biologique est souvent certifié selon des normes reconnues telles que le label Global Organic Textile Standard (GOTS). Ces certifications garantissent que le coton est cultivé et transformé conformément à des critères environnementaux et sociaux stricts, y compris la protection de la biodiversité, la gestion responsable des déchets, et le respect des droits des travailleurs.
Le coton biologique offre une alternative plus écologique à la culture conventionnelle du coton, réduisant ainsi l’utilisation de produits chimiques nocifs pour l’environnement, la santé des agriculteurs et la qualité des sols. En choisissant des produits fabriqués à partir de coton bio, vous soutenez une production plus durable et respectueuse de l’environnement.
Crédit photos: Freepik